par Jean de Kervasdoué – Article paru dans Le Point le 4 décembre 2023
La réponse des villes au délabrement du système de soins
Au congrès des maires de France, le 22 novembre, l’accès aux soins médicaux fut au centre des débats. La séance, dans une salle bondée, avait pour titre : « L’organisation locale au secours de la défaillance nationale ». Il n’était pas usurpé. Aurélien Rousseau, Ministre de la santé, bienveillant, a promis à cette occasion qu’il ne « fermerait jamais d’hôpital pour raison
financière » et que, par ailleurs, « tant qu’on peut garder un service ouvert, on le gardera ouvert ». Peut-être, mais qu’est-ce que cela veut dire, tant le mot « hôpital » recouvre des entités disparates ? En outre, certains établissements qui prétendent faire de la chirurgie n’ont plus d’anesthésistes pour assurer la permanence des soins ? Faut-il vraiment garder un service ouvert alors qu’il est dangereux ? En outre, promettre comme il le fit, de soutenir les initiatives locales va sans dire, mais une telle déclaration me semble être surtout un aveu de faiblesse, un manque d’imagination et … de courage.
Cette semaine-là, au même moment donc, il m’a été donné de regarder de plus près l’évolution du système de soins dans deux départements ruraux : le Lot et Garonne et la Nièvre. Comme chacun le sait, ils ne sont ni au bord de la mer, ni dans les zones montagneuses des frontières de l’est, ces territoires qui attirent encore les jeunes médecins passionnés de sports nautiques ou de montagne. Une plongée dans les départements ruraux suscite à la fois l’admiration et la honte. Admiration lorsque l’on découvre la manière dont les collectivités locales, pourtant peu ou pas compétentes en matière de santé, font preuves d’imagination et parviennent ainsi à ce que subsistent sur leur territoire des soins de proximité, dégradés certes, mais existants. Ils sont animés par une foi militante. A force d’engagement, voire de passion, les acteurs locaux aidés par leur agence régionale de santé (ARS), permettent en effet qu’un système bricolé serve la population. Toutefois, sans réformes d’une autre ampleur, cela ne sera plus possible d’ici la fin de la décennie.
A ce stade aussi, la honte devant le constat d’échec des politiques gouvernementales du dernier quart de siècle m’a saisi. Elle devrait être partagée par la classe politique, la haute fonction publique, les doyens de faculté de médecine et les syndicats médicaux. Ils ont chacun de lourdes responsabilités dans le délabrement actuel : en effet, à une évolution systémique, il n’a été répondu que par des réformes inadaptées (notamment celles des études des professions de santé), par des expérimentations (1) pour certaines prometteuses, mais jamais généralisées et surtout une politique marquée, à l’exception de la période Covid, par la centralisation et la seule volonté de contraindre la croissance des dépenses d’assurance maladie en ne réformant pas la médecine de ville, tout en bureaucratisant chaque jour le fonctionnement de l’hôpital.
Ainsi, s’il y a encore 79 généralistes dans le Lot et Garonne, 47 ont plus de 55 ans, or le taux de ce département est déjà bas : 68,7 généralistes pour 100 000 habitants alors que le taux moyen hexagonal est de 89,2. Pour les psychiatres libéraux c’est pire : il en reste 6 et ils ont tous plus de 55 ans ! Les pédiatres libéraux ne sont que 3, dont un de plus de 55 ans et l’on pourrait continuer à citer des chiffres en gynécologie-obstétrique, en dermatologie. Dans le Lot, département voisin, la crainte de l’avenir prédomine aussi : les huit ophtalmologues ont plus de 65 ans… La crise est universelle dans ce type de territoire ; elle se fait d’ailleurs déjà sentir dans les territoires dits « favorisés ». Dans les villages, le système tient pour l’essentiel grâce aux infirmiers libéraux ; mais, là aussi, cela ne va pas durer du fait des réformes récentes et notamment de « Parcours-sup » qui, contrairement au système antérieur, ne recrute plus localement école par école, mais régionalement. Ainsi la moitié des étudiants (es) admis aujourd’hui dans les instituts de formation de soins infirmiers (IFSI), ne sont pas du département et démissionnent donc immédiatement en attendant de pouvoir trouver un institut de formation proche de leur domicile. Quant aux spécialistes libéraux qui demeurent, certains de ceux qui sont surchargés de travail se déconventionnent pour avoir moins de patients et maintenir, voire dépasser leur niveau de revenu antérieur. Qui les jugera ?
Pourtant les collectivités locales (départements et villes), avec les caisses primaires d’assurance maladie, réagissent. Les villes de Nevers et d’Agen font donc tout pour attirer des internes en stage, ce serait déjà cela de pris, mais en espérant surtout qu’ils viendront plus tard s’installer. Non seulement un logement leur est proposé à un prix modique, mais encore leurs requêtes sont le plus souvent suivies. A Agen, des internes voulaient bénéficier d’œufs frais (et vraisemblablement « bio »), on leur a donc aménagé un poulailler aux pieds de l’Internat ! On leur a aussi installé un barbecue, une allée pour jouer à la pétanque …. Après l’Internat, il leur est offert des bourses d’installation puis, souvent, la gratuité totale de leur lieu d’exercice. L’hôpital public et la clinique ont depuis longtemps cessé toute guerre picrocholine et se coordonnent pour offrir à la populations l’accès à des spécialités complémentaires. Les télés-consultations se développent. Si, en radiobiologie, alors que l’examen a par essence lieu sur place par un manipulateur, son interprétation peut être faite à distance par un radiologue qui, certains jours de la semaine, préfère le surf à la pêche à la ligne le long du Lot : il peut en effet voir les images et rédiger ses comptes-rendus à distance.
La ville et l’agglomération d’Agen ont, depuis 2014, créé un service dédié à la santé et, notamment, signé avec tous les partenaires publics et privés un « Contrat local de santé » (CLS). Un conseil local de santé mentale a aussi été créé avec le centre hospitalier départemental psychiatrique, les services de gérontologie et les services d’urgence. Elles accompagnent également le développement du CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé) qui contribue à la coordination des soins comme toutes les initiatives en matière de prévention et souhaitent, notamment, que les jeunes enfants des classes maternelles puissent voir au moins une fois un médecin avant l’âge de six ans ! Ce n’est pas le cas de tous. Tout ceci pour ne citer que quelques réalisations de la manière dont ces collectivités participent à l’aménagement de leur « territoire de santé » (2)
Certaines des causes de cette dégradation, qui va se transformer en déliquescence, sont connues, d’autres moins. La première est que le numerus clausus de la fin de première année des études de médecine qui s’est transformé, nous l’avons vu dans ces colonnes, en numerus apertus, ne change rien si ce n’est que certaines facultés de médecine ont fait une vague promesse d’accroître de 10% leurs étudiants en seconde année. Rappelons qu’il faut dix ans pour former un médecin.
Mais il existe aussi un second numerus clausus, lui moins connu, mais aux toutes aussi lourdes conséquences. Il se place au début de l’Internat et précise chaque année le nombre de places ouvertes par spécialité (dont la médecine générale). Or, il est évident que ce qui domine dans cette décision administrative du nombre de places ouvertes, à part la médecine générale, ce sont les besoins hospitaliers, pas ceux de la ville ! En outre, le choix de chaque interne va dépendre de son classement, ce qui créé un beau mécanisme de frustration car l’on ne devient pas psychiatre faute de n’avoir pu être chirurgien !
Par ailleurs, depuis toujours, en France, le cursus honorum des études de médecine a été celui des spécialistes et, contrairement aux pays de l’Europe du Nord, les généralistes ont été formés par défaut. Ce déclassement relatif, comme d’ailleurs celui des spécialités purement cliniques (pédiatrie, gérontologie, psychiatrie, gynécologie médicale), se retrouve dans le tarif des consultations et dans celui de leur revenu annuel. Grosso modo, d’un point de vue financier : un généraliste = un spécialiste – 30%. Quant aux anesthésistes, en me réjouissant pour eux de ce qu’ils gagnent, on cherche néanmoins la raison qui expliquerait pourquoi leur revenu annuel moyen est trois fois supérieur à celui d’un pédiatre. Ce déclassement financier explique à l’évidence pourquoi ces spécialités ne sont pas les plus recherchées, même si aujourd’hui la
formation d’un généraliste est aussi longue que celle d’un spécialiste, sans qu’il leur soit encore expliqué comment, en ce début décembre 2023, leur quatrième année d’internat allait leur être payée !
Si l’on savait depuis des décennies que les femmes médecins travaillaient de l’ordre de 80% du temps de leurs confrères masculins, le numerus apertus ou clausus n’a cependant pas tenu compte des conséquences arithmétiques de la féminisation de la profession. En outre, et l’effet est déjà manifeste, le rapport au travail change dans toute la génération des moins de 35 ans. Ainsi, dans un des hôpitaux de ces départements, heureux d’avoir recruté un urgentiste, celui-ci a expliqué qu’il ne travaillerait que 15 jours par mois car, a-t-il dit : « je viens d’acheter un terrain et je vais y construire ma maison ». Quant à sa compagne, pédiatre, également recrutée, elle l’a été, à sa demande, pour 24 heures par semaine.
Pour toutes ces raisons, la situation va donc se détériorer car la génération du baby-boom vieillit et va bientôt entrer dans les âges de la dépendance (83-85 ans). En outre, du seul fait des innovations technologiques, la demande de soins augmente et augmentera, ces deux effets se cumulent donc. A moins que : l’on ne réforme la réforme des études de médecine ; que le recrutement des professions paramédicales soit, comme c’était encore récemment la pratique, local ; que l’on forme entre 3 000 et 5 000 infirmières de pratique avancée en augmentant leur rémunération et que le paiement à la capitation se généralise. Rappelons que ce système est libéral car les patients choisissent leur médecin. Celui-ci n’est alors plus payé à l’acte, mais reçoit un forfait annuel de l’assurance maladie pour la prise en charge de chaque malade. Ce type de rémunération contraint les médecins à trouver leur patientèle et donc à se répartir en fonction de la population.
Enfin, si jusqu’à ce jour, j’étais contre la remise en cause de la liberté d’installation, je propose aujourd’hui, qu’à l’instar des ingénieurs des corps de l’état, les médecins qui ne souhaiteraient pas s’installer pour une durée à définir (5 ans ?) dans une des zones aux besoins criants, payent une partie ou la totalité du coût de leurs études de médecine. Ne savent-ils pas, pour me limiter à cet exemple, que le seul droit d’inscription à la faculté de médecine d’Harvard fut en 2022 de 74 900 $, soit 300 000 $ environ pour un minimum de 4 ans et ceci sans compter ce qu’il faut pour vivre chichement à Boston (de l’ordre de 30 000 $ par an), soit donc au total sur quatre ans de l’ordre de 420 000 $ et c’est un minimum ? En France, on pourrait faire un prix, disons : 100 000 € pour les dix ans d’étude et les rémunérations versées aux externes et aux internes.
Cette situation française, succinctement décrite, montre que le temps n’est plus aux mesurettes actuelles et au maintien d’un système qui, à l’évidence, mène aux drames, malgré le dévouement et l’imagination créatrice des collectivités locales contraintes par une centralisation paralysante et des lois qui ont à l’évidence échoué. Rappelons que si, heureusement, les soins médicaux sont pour l’essentiel gratuits en France, encore faut-il des soignants pour les
prodiguer ! On n’en prend pas le chemin.
1 Elles ont été permises par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018.
2 AggloAgen, Livret blanc, « Comment l’Agglomération d’Agen participe à imaginer notre territoire de santé de demain », Novembre 2022

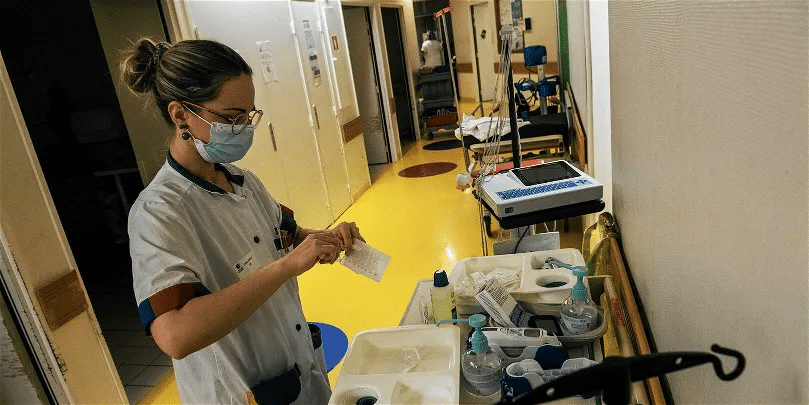
En écho aux débats du Salon des Maires sur la désertification médicale, l’étude de Jean de KERVASDOUE sur deux départements ruraux.
Édifiant et inspirant, comme on dit maintenant.